La barbarie à visage humain de Bernard-Henri Lévy
Catégorie(s) : Sciences humaines et exactes => Philosophie , Sciences humaines et exactes => Economie, politique, sociologie et actualités
un livre essentiel pour comprendre notre époque
A la fin des années 70, Bernard-Henri Lévy, qui n'était pas encore BHL, écrit une sorte de témoignage d'enfant du siècle qui fait le bilan des expériences idéologiques du XXème siècle et attaque les philosophes progressistes, avec un style par moments éblouissant et par moments irritant par excès d'emphase. Annonçant la fin de l'Histoire par l'avènement du capitalisme, proclamant le triomphe inéluctable de la barbarie technicienne, il dénonce les promesses des théories progressistes dont le socialisme n’est qu’un avatar.
Je vous propose ci-dessous un long résumé, bien plus qu'un commentaire, de cette oeuvre qui a propulsé BHL sur le devant de la scène médiatique et littéraire et a suscité de nombreux commentaires contradictoires. Je pense que c'est une oeuvre qui mérite d'être lue car elle dit des choses importantes sur les relations entre l'Homme et l'Etat (dans une perspective qu'on peut clairement qualifier de néo-conservatrice, et qui est parfois discutable) et révèle certains fondements de notre société. Elle éclaire aussi la conception du Pouvoir selon BHL, qui est une éminence grise de nos dirigeants politiques et eut l'oreille attentive de F.Mitterrand, de J.Chirac et de N.Sarkozy.
BHL commence par contester les définitions classiques du Pouvoir dans les théories progressistes.
La gauche politique traditionnelle s’appuie sur une théorie du Pouvoir selon laquelle les hommes dominés sont manipulés par une idéologie au service des dominateurs, qui asservit les masses et les incite à accepter leur situation. L’oppresseur est alors défini comme le directeur lucide qui gouverne l’inconscient collectif de masses maintenues en sujétion par l’ignorance de leur condition. L’acte révolutionnaire est donc celui qui apporte le savoir et le pouvoir libérateur de la vérité. Pour BLH, ce schéma est grossièrement faux car l’Histoire montre l’inertie des masses qui, même averties de leur situation (ex : vaste diffusion du marxisme) ou d’un péril imminent (ex : nazisme), consentent bien plus qu’elles ne luttent.
BHL démontre aussi l’inanité du courant novateur de la gauche marxiste (incarné par Deleuze), qui pense avoir résolu cette contradiction en intégrant la dimension du « Désir » tel que défini par Reich. L’asservissement des masses résulterait de leur jouissance à être dominées par le Prince, qui suscite leur amour. La révolution ne serait possible que par abstinence du désir, inversion de la libido des masses ou report vers la figure du rebelle… Malgré son apparence iconoclaste, la rhétorique des néo-marxistes n’est qu’un décalque inversé de celle des marxistes et est contredite par l’Histoire : la bourgeoisie actuelle est le premier maître qui ne suscite plus de fascination (cf Bataille) et le peuple allemand a versé dans le nazisme pour échapper à une terrible crise économique bien plus que par désir d’Hitler.
Pour échapper aux impasses gauchistes, BHL affirme qu’il est nécessaire de reconnaître deux idées forces : le Maître n’est pas rien (il est concret et dispose d’outils réels pour exercer le pouvoir) et le Maître est un presque rien (malgré sa puissance, le Pouvoir peut être mis en crise et le Maître peut être destitué). En fait, le Pouvoir n’est pas rien mais, même s’il y a des agents et des tenants du Pouvoir, son essence n’est pas matérielle : il est un être de raison qu’il convient de penser non comme un principe contaminant, qui s’écoulerait d’une source localisée et se propagerait, mais comme une émanation de l’ensemble de la société qui projetterait à l’extérieur d’elle-même une sublimation de son « moi » idéal. BHL rejoint La Boétie, qui a posé le premier le problème de la servitude volontaire ; il atteste que les hommes produisent leur soumission mais ne la désirent pas et ne cessent de protester contre son joug. La Révolte n’est donc pas un contre-pouvoir mais la reconduction du Pouvoir sous une nouvelle figure. Il n’y a pas de dualité de principes idéologiques antagonistes car il n’y a pas d’alternative au Pouvoir.
Pour BHL, la métaphore la plus juste du Pouvoir est celle du fantasme, c’est-à-dire un irréel capable de s’imposer au réel dont il est issu et de le modeler afin de faciliter sa subsistance. Le Pouvoir n’est pas le fait des sociétés ou du Prince ; il est, ainsi que l’avait pressenti Rousseau, une nécessité de la nature humaine tant qu’elle se coalisera en lien social. Le Pouvoir est ce qui transforme en société humaine la multitude des hommes qui renoncent, par cette union, à leur bonheur individuel.
Pour BHL, il faut donc cesser de concevoir le Pouvoir comme un carcan et rompre avec la pensée progressiste qui cherche à aménager, contre l’Etat, des îlots de libertés et de droits naturels. C’est le Pouvoir qui structure et permet le désir libertaire et révolutionnaire. Pour cette raison, le Pouvoir ne peut que toujours triompher. En fait, s’il n’est de désir ou de parole qui échappe au Pouvoir, c’est qu’il n’est en fait rien de réel qui soit hors du Pouvoir. Les dirigeants politiques affichent une conception matérialiste de l’Histoire, fondée sur une croyance en des évènements factuels et objectifs, mais ils savent en même temps, comme les épistémologues, que la politique est l’art de façonner le réel. Le réel n’est pas asservi mais engendré par le Pouvoir. En conséquence, il ne peut y avoir d’état de nature de la société humaine préexistant au monde construit par le Pouvoir, qui apparaît comme la forme « a priori » de la réalité. Nietzsche, le premier, a évoqué les forces actives et les forces réactives qui modèlent le fonctionnement dynamique du Pouvoir et sa capacité démiurgique à organiser le réel, en régulant le jeu des forces d’intégration et des forces de décomposition. L’erreur des utopistes, depuis les stoïciens jusqu’aux socialistes modernes et aux écologistes de la « convivialité », est de croire en la possibilité d’une réalité – un Ailleurs - non soumise au Pouvoir. L’erreur des socialistes est de s’appuyer sur une philosophie de l’Histoire : les soubresauts révolutionnaires ne sont radicaux que par leur ponctualité, qui est rébellion contre le Temps (cf. la systématique volonté révolutionnaire de faire table rase du passé) mais ne peuvent s’inscrire dans la durée historique parce que celle-ci est un lieu du Pouvoir.
BHL dénonce la fausseté des philosophies optimistes de l’Histoire. Depuis les Lumières, opposant l’individu et la nature humaine au Léviathan qui l’oppresse (la tâche des philosophes étant d’éclairer l’entre-deux pour maintenir un juste équilibre), les optimismes s’appuient tous sur l’idée d’un « état de nature » préexistant aux institutions, qu’il faudrait libérer de l’asservissement du Pouvoir. Or il n’y a rien avant le Pouvoir et il n’y a pas d’Histoire avant l’Etat : l’Etat est contemporain de l’Homme et son existence, puisqu’elle est sans cause, n’a pas à être justifiée ou condamnée. Les marxistes, à la suite d’Engels, ont vainement tenté d’affiner leur théorie sur l’origine de l’Etat mais seul Proudhon a pressenti que l’organisation des pouvoirs précède celle des modes de production.
De même qu’il n’y a pas d’Histoire avant l’Etat, il ne peut y avoir d’Histoire après l’Etat. Le dépérissement de l’Etat puis l’avènement d’une Histoire sans l’Etat sont impossibles car l’Etat, une fois advenu, est coextensif à l’Histoire. Même s’il a pu exister des sociétés sans Etat, il n’y a pas d’exemple d’une société de pouvoir ayant pu devenir société sans Etat. C’est l’une des causes principales de l’échec de Lénine à perpétuer sa révolution : il ne pouvait effacer l’Etat sans vouloir abolir l’Histoire (ce qu’ont en revanche compris et tenté les Chinois).
L’inexistence d’un « état de nature » originel impose également d’affirmer, de même que Nietzsche dans La volonté de puissance, que l’individu n’existe pas antérieurement et face à l’Etat. L’individu existe d’abord comme étant une partie d’un tout (qui est l’Etat) et il n’acquiert ses facultés individuelles que progressivement, en devenant un homme libre. L’individu n’étant rien sans l’Etat, il n’est pas opprimé (puisqu’il ne possède rien qui ne soit donné par l’Etat) et ne peut être libéré, puisqu’il n’existe pas hors de l’Etat. Il ne peut donc y avoir de révolution contre l’Etat sans rompre avec l’individuation. En ce sens, seuls les Chinois de la Révolution culturelle, cherchant à briser la « volonté propre », et les premiers chrétiens, expérimentant la radicale impossibilité du moi, furent d’authentiques révoltés. Néanmoins, BHL admet que l’Etat, débarrassé de l’illusion de l’individu, sombre inévitablement dans le totalitarisme et la terreur (fascisme, oppression stalinienne ou jacobine). Chamfort, dans ses Maximes, fut l’un des rares intellectuels des Lumières à comprendre que la seule révolution possible était dans les esprits et que la seule échappatoire à la menace de la barbarie de l’Etat total est la distinction entre l’ordre de la politique et l’ordre de l’éthique.
Parce qu’il est convaincu de l’avènement historique de la société nouvelle, le socialisme est la version la plus gravement mensongère des philosophies optimistes. Il enregistre et interprète tous les évènements historiques de manière à conforter sa thèse, et s’apparente ainsi à une nouvelle religion dont le Prolétariat (qui est une prophétie bien plus qu’une réalité car il n’existe pas en tant que classe constituée ayant la faculté de l’émancipation universelle) serait le Dieu et la dialectique historique son martyr. Le socialisme n’a aucune capacité créatrice en lui-même et ne mène que des combats de paroles ou de réactions contre la société bourgeoise, qu’il ne peut renverser car il ne peut exister sans elle. En fait, le socialisme justifie la bourgeoisie, en fournissant une explication ontologique au Pouvoir qu’elle exerce, s’organise selon la forme suscitée par le Pouvoir. Il apparaîtrait sans doute, si des études historiques étaient menées sur la fonction de la grève ou le rôle des syndicats, comme une force de régulation au service du Pouvoir. En ce sens, le socialisme a pu jouer en Europe un rôle bénéfique d’harmonisation et d’apaisement contre les menaces de l’anarchie révolutionnaire ou de l’Etat totalitaire (cf Jaurès et le double combat du socialisme) mais il n’est, en définitive, qu’un lieu du « moindre Mal », un subterfuge du Pouvoir pour le rendre supportable et non le héraut d’un autre lieu où le Maître ne serait plus.
La prédiction socialiste de l’agonie du Capitalisme repose sur la thèse erronée que ses contradictions internes génèrent des crises récurrentes et croissantes, qui l’affaiblissent progressivement et le feront s’effondrer. Ils assimilent le Capitalisme à un corps vivant soumis à des phases inéluctables de croissance et de déclin, dont ils diagnostiquent, en médecin, le vieillissement et les maladies. En fait, comme l’ont compris les anarchistes (« révolution permanente ») et les socialistes réformateurs, l’idée de crise révolutionnaire est vide de sens. Rompant avec les sociétés passées, le Capitalisme, contemporain d’une révolution scientifique qui a établi le temps linéaire et l’espace indéfini, échappe à la mort des civilisations en se nourrissant de ses contradictions (crises financières, structurelles et sociales) pour organiser sans cesse son propre dépassement ; il est impérissable car sans cesse en métamorphose et les crises apparentes qui le secouent ne sont que les signes de vitalité de son équilibre dynamique.
En définitive, il n’y a pas d’issue au Capitalisme et à son nihilisme, car sa cohérence est parfaite. Le capitalisme, en tant que gestion des choses sociales, est l’aboutissement de la philosophie occidentale telle qu’elle naquit en Grèce : il est la fin de l’Histoire du monde occidental mais il n’est pas un morne processus itératif de transformation et d’évolution. Le nazisme et le stalinisme ont montré qu’il pouvait engendrer l’horreur.
BHL affirme alors que la barbarie fasciste est l’état paroxystique du capitalisme, dont la tyrannie et la décadence doivent se comprendre au sens platonicien. Le marxisme n’échappe pas à cette barbarie car son explication de la lutte des classes constitue une justification ontologique du capitalisme. La société sans classe réduit le monde à une équipollence similaire à celle du Capital, qui s’incarne dans les plans quinquennaux du stalinisme (qui n’est rien qu’une économie bourgeoise mise sous contrôle de la police) et les goulags (qui ne sont que les cachots des Lumières). Marx fait l’apologie du travail pour bâtir une société nouvelle émancipée de la nature (cf son commentaire sur Darwin) grâce au pouvoir démiurgique de la technique, substituant ses machines et ses lois au désordre et aux inégalités de la nature, poussant à son paroxysme la barbarie qu’il voulait éradiquer. Le socialisme est essentiellement, derrière un discours de rupture, la théorie d’une continuité (cf Marx : le communisme « résulte des conditions actuellement existantes ») infléchie vers l’objectif d’une société nouvelle qui est en réalité totalement déterminée par l’héritage de la bourgeoisie. Les manuels d’éducation marxistes ne visent qu’à progressivement modeler la pensée, sous couvert de la perfectionner, pour extirper ou réprimer ce qui le rend impure vis-à-vis de l’orthodoxie. C’est par ce biais que le socialisme peut verser dans la barbarie. Contre les bonnes âmes d’aujourd’hui, qui revendiquent l’héritage des Lumières, il nous faut apprendre à ne plus retenir les notions de « progressistes » ou de « réactionnaires » comme les critères pertinent d’appréciation des forces politiques.
La barbarie du progressisme s’incarne dans le Capital. Ce Mal n’est pas illusoire : il est le réel du monde. La seule révolution réussie du siècle est celle de l’Etat totalitaire, car le Pouvoir tend nécessairement à l’absolu. Staline et Hitler sont des penseurs politiques insuffisamment pris au sérieux, qui ont compris que l’Etat libéral est un Etat totalitaire qui s’auto-censure et dont il suffit de briser les freins. La conscience et la mobilisation des masses, que les socialistes ont érigées en barrage, n’ont pu enrayer le fascisme ; seule la religion a pu, dans l’Histoire, constituer une digue efficace contre le déferlement du Pouvoir. Aujourd’hui, la crise du Sacré et l’avènement de l’Etat athée ont sapé les fondements religieux de la civilisation, augurant le décès concomitant de la Politique dans un Etat désacralisé qui renonce à la transcendance ou lui substitue une immanence profane divinisée, ainsi que le firent Hitler avec le culte des Morts et de la Terre (là réside son unique lien avec le vitalisme de Nietzsche, qui peut expliquer l’adhésion de Heidegger au nazisme) et Robespierre avec le culte terrestre de l’Etre suprême et du Bien Public, punissant de mort toute infraction au dogme et déchaînant le Mal (ce que Sade fut le seul à pleinement comprendre).
L’affaiblissement de la Religion provoque également une confusion du Prince et du Souverain. Alors que les Etats ont toujours tenu les lois et les principes comme des émanations d’un ordre transcendant (Dieu, le Peuple, etc.) dont le Prince n’est qu’un représentant aux pouvoirs bornés par le respect dû à cette instance suprême, les dictateurs totalitaires se sont arrogés le droit d’écrire la loi et d’investir le champ dévolu à la transcendance. Le culte de la personnalité dans les Etats totalitaires s’explique par l’identification du Prince et du Souverain, justifiant le mot d’Hitler : « Vous serez comme des Dieux ». En raison de l’omniprésence et de l’omnipotence du Prince, l’Etat totalitaire se caractérise également par sa régulation administrative et coercitive de l’ensemble de la société civile, qui ne laisse aucun espace à la contradiction.
En réalisant l’appropriation et l’administration par l’Etat du corps de la société, l’Etat totalitaire organise méthodiquement toute la société et instaure une dictature scientifico-idéologique en imposant l’unité d’un discours qui légitime son action et modèle une image du réel. Le totalitarisme n’est donc pas une figure de l’obscurantisme : il recherche au contraire la plus grande transparence pour traquer les poches de dissidence et inhiber l’expression privée, comme l’illustrent les actions de masse dans la rue (où l’individualité s’efface) et le culte de la lumière (Lénine électrifiant la Russie ; l’hymne à la clarté concluant le Léviathan de Hobbes, que Staline avait lu et médité ; les retraites aux flambeaux des nazis). En conséquence, l’Etat totalitaire ne cesse d’inventer des procédures pour faire parler les masses et les contraindre à avouer leur adhésion ou à confesser leurs pensées privées (cf. les procès staliniens ou la théorie maoïste sur la parole populaire).
L’Etat totalitaire est celui où rien n’est privé et tout est politique. Il faut donc se méfier des revendications exigeant la libéralisation de la parole (levée du secret de l’instruction judiciaire, étalage de l’intimité au nom de la libéralisation des mœurs, etc.). Par ailleurs, l’omniprésence de l’Etat tend à le confondre avec la société et à le rendre invisible (cf. subtilités des discours soviétiques, établissant une distinction entre l’abolition et le dépérissement de l’Etat prolétarien)
Pour BHL, l’avènement de la barbarie, qu’élaborent les théoriciens des totalitarismes (de Joseph Staline à Carl Schmitt [idéologue nazi]), est inéluctable. Le Dante de notre temps est Soljenitsyne, qui a dissipé l’illusion entretenue par les communistes que le Goulag dérivait des erreurs staliniennes. Le Goulag est marxiste comme la chambre à gaz est nazie. Les écrits de Karl Marx permettent de pressentir l’Etat policier dans la société sans classe car celle-ci ne peut être réalisée sans refouler et écraser les forces rebelles ou marginales qui menacent son homogénéité.
Il faut ainsi comprendre que le Travailleur est la figure de la société future, homogène et uniforme dans son néant. Le prolétariat, même s’il n’existe pas en tant que corps constitué doté d’une unité politique, modèle toutes les idéologies occidentales et dicte le fonctionnement de la société industrielle. En fait, le Capital, sans cesser d’être, semble avoir intégré le prolétariat et adopté ses valeurs et ses représentations. Marx, dans ses Etudes philosophiques, avait envisagé succinctement cette évolution du Capital qu’il appelait « un communisme grossier et vide de pensée », qui supprime la lutte des classes en généralisant les conditions de l’ouvrier mais maintient le Capital, sous une forme uniformisée, dans un champ social unifié.
Le marxisme est la religion du nouvel âge prolétarien. C’est d’ailleurs la seule grandeur de l’idiosyncrasie communiste. Marx, en même temps qu’il a stigmatisé la religion, la décrit en des termes [« La religion est la théorie générale de ce monde (…) La religion est le soupir de la créature accablée ; elle est l’âme d’un monde sans cœur ; elle est l’esprit d’un monde sans esprit. Elle est l’opium du peuple »] qui s’appliquent aujourd’hui mot pour mot à l’analyse marxiste du Capital, devenue à son tour la théorie générale du monde à laquelle se réfèrent, directement ou indirectement, tous les penseurs, même libéraux. De même, les penseurs marxistes ont développé des analyses de tous les domaines de la pensée, de l’urbanisme à la psychanalyse et à la littérature, pour former un compendium encyclopédique aussi universel que celui de l’Eglise, identiquement scindé en deux parties relativement autonomes qui s’adressent respectivement aux élites et aux masses. Sur cette base dogmatique, à l’identique des prêtres chrétiens, les marxistes s’érigent en références cardinales de Justice (cf les procès de Moscou, tenus avec le quasi-consentement des condamnés) et prophétisent, par la grâce de la dialectique, un avenir radieux aux miséreux d’aujourd’hui. En conséquence, le marxisme reproduit envers le Capital les mêmes compromis qu’autrefois l’Eglise envers Rome. Contrairement aux discours usuels (nota : le livre fut écrit juste après mai 68), le marxisme n’est pas en crise et, malgré l’apparence d’un déclin, imprègne tous les penseurs même quand ils ne s’en réclament pas et, plus important, a contaminé les masses qui n’ont jamais lu Marx. Davantage qu’une explosion libertaire de la jeunesse et qu’une rupture des socialistes avec le stalinisme, Mai 68 marque le point de retournement de l’idéologie libérale, qui a intégré le vocabulaire marxiste dans son discours pour rallier ses sympathisants. Cette récupération, qui installe le marxisme au cœur du jeu politique, semble totalement en avoir tari la fécondité conceptuelle. En fait, le marxisme est devenu une vulgate qui se dilue dans son expansion et devient stérile. De même que la vulgarisation du Latin coïncida avec le déclin de l’empire romain, le marxisme, puisqu’il est devenu le langage commun de la politique, ne peut porter aucun projet révolutionnaire. Il n’y a plus de langue et plus de politique en dehors du marxisme qui puisse être un recours possible pour déstabiliser sa puissance logique. Il ne nous reste que le devoir moral de protester. La seule mission de l’Intellectuel est de témoigner contre la barbarie, pour en retarder la venue… Même si nous savons depuis Nietzsche que Dieu est mort, BHL proclame la nécessité d'un spiritualisme athée pour croire encore en l’Homme et l'inanité de la figure du Révolté.
Les éditions
-
La Barbarie à visage humain
de Lévy, Bernard-Henri
le Livre de poche
ISBN : 9782253037408 ; EUR 5,10 ; 01/05/1985 ; 216 p. ; Poche
Les livres liés
Pas de série ou de livres liés. Enregistrez-vous pour créer ou modifier une série
Forums: La barbarie à visage humain
| Sujets | Messages | Utilisateur | Dernier message | |
|---|---|---|---|---|
| Etat et histoire | 2 | Mr.Smith | 28 avril 2013 @ 22:53 |




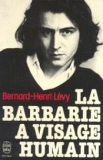


 haut de page
haut de page